BLOG
PREMIèRE IMPRESSION : un atout pour LES FEMMES LEADERS ?
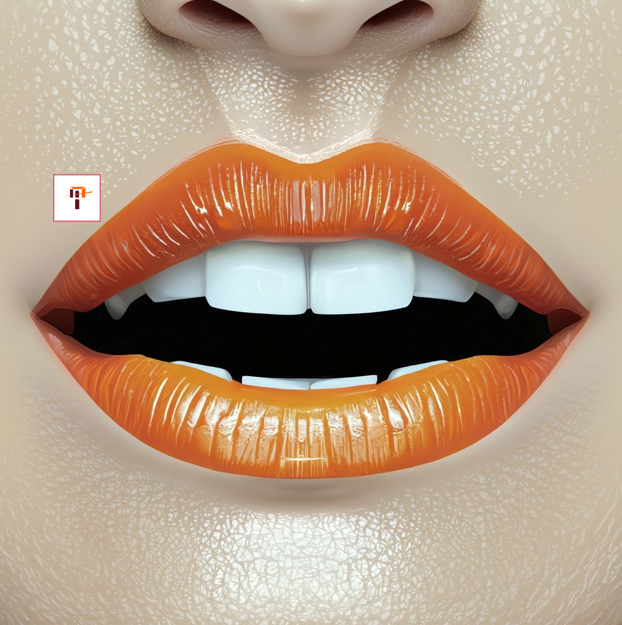
La psychologie sociale et les neurosciences confirment les intuitions. Selon des études, les premières impressions se forment en environ 0,1 à 0,5 seconde. Cela montre à quel point notre cerveau est rapide pour juger les traits de personnalité basés sur des signaux non verbaux. Une étude de Willis et Todorov (2006) a révélé que les personnes pouvaient évaluer des traits tels que la confiance, la compétence, et l’attrait, sur la base d’une image d’une fraction de seconde. Les jugements pour des traits tels que la compétence et la sympathie se font presque instantanément. Une étude de Forster et al. (2017) a indiqué que lorsque les individus forment une première impression, ils ont tendance à rechercher des informations qui confirment leur impression initiale plutôt que des informations qui pourraient la contredire. C’est ce qu’on appelle le biais de confirmation.
Plus précisément, des recherches ont montré qu’un contact visuel soutenu pendant la première interaction peut augmenter la perception de confiance. Ainsi, les interlocuteurs jugés comme ayant un bon contact visuel sont généralement perçus comme plus compétents. Enfin, des études ont montré que l’attrait physique contribue également à la formation des premières impressions, les personnes considérées comme attrayantes bénéficiant souvent d’une perception plus positive. Les mêmes recherches précisent que, bien que l’attrait physique soit important pour les deux sexes, les hommes peuvent accorder plus d’importance à l’attrait physique lors de l’évaluation d’une femme, tandis que les femmes peuvent porter plus d’attention à la personnalité ou à des traits de compétence.
L’importance de l’apparence, lors de la première impression et ensuite, est également genré . Normes et attentes sont beaucoup plus exigeantes quand il s‘agit des femmes. Ainsi, côté attente, des sondages récents attestent de l’importance du maquillage, même après les années Covid. Il existe bien sûr des différences en fonction du secteur d’activité. Cependant, très majoritairement, femmes et hommes estiment que le maquillage – un maquillage adapté- augmente l’impression de professionnalisme. Coté norme, le concept de male gaze est éclairant pour comprendre la différence de perception entre l’apparence d’une femme et celle d’un homme.
Le “male gaze”, littéralement “regard masculin” est un concept théorique développé par Laura Mulvey en 1975. Il désigne la manière dont la culture visuelle (cinéma, télévision, publicité) est façonnée par une perspective masculine et présente les personnages féminins de manière à plaire à un public masculin. Ce phénomène a contribué fortement à la sexualisation et à l’objectification du corps féminin. A l’écran, celui-ci est souvent réduit à un objet de désir et existe peu comme sujet autonome et complexe. Une telle injonction du devoir-plaire, diffusée en masse et depuis longtemps, est intériorisée pas toutes et tous et s’ajoute à des normes de beauté contraignantes. Sur le plan cognitif, face à un auditoire, le message d’une femme qui prend la parole est toujours en concurrence…avec son apparence. Son apparence peut la servir ou la desservir. Il faut donc absolument intégrer cette donnée pour maximiser l’écoute et l’attention.
En plus de l’apparence, la posture physique est également soumise à des biais puisque le non verbal associé classiquement au leadership (affirmation de soi, dominance, extraversion, etc.) n’est pas interprété de la même façon suivant qu’il émane d’un homme ou d’une femme. Les femmes peuvent être jugées plus sévèrement pour des comportements assertifs ou dominants, tandis que les comportements similaires chez les hommes peuvent être valorisés. Les signaux généralement associés à la confiance et à la dominance comme une posture corporelle ouverte, prenant de l’espace, épaules en arrière et buste dégagé, un contact visuel soutenu, des gestes expansifs, un ton de voix bas à forte résonance, des expressions faciales confiantes, ou encore le fait de prendre l’initiative dans les échanges oraux, de diriger les discussions, ou d’empiéter sur la distance proxémique (distance personnelle dans l’interaction entre deux personnes) ne sont pas interprétés de la même façon. Parallèlement, des postures typiquement associées à la féminité (gestuelle discrète, voix douce, regard évitant et modeste, visage penché sur le côté ou vers le bas, taille cambrée, sourire très fréquent, jambes croisées, déhanchement en posture debout, parole en retrait, distance proxémique plus grande) peuvent séduire et/ou rassurer, mais risquent de ne pas convaincre. D’où le dilemme : féminine, mais pas assez leader, ou bien leader mais pas assez féminine …


Le “male gaze”, littéralement “regard masculin” est un concept théorique développé par Laura Mulvey en 1975. Il désigne la manière dont la culture visuelle (cinéma, télévision, publicité) est façonnée par une perspective masculine et présente les personnages féminins de manière à plaire à un public masculin. Ce phénomène a contribué fortement à la sexualisation et à l’objectification du corps féminin. A l’écran, celui-ci est souvent réduit à un objet de désir et existe peu comme sujet autonome et complexe. Une telle injonction du devoir-plaire, diffusée en masse et depuis longtemps, est intériorisée pas toutes et tous et s’ajoute à des normes de beauté contraignantes. Sur le plan cognitif, face à un auditoire, le message d’une femme qui prend la parole est toujours en concurrence…avec son apparence. Son apparence peut la servir ou la desservir. Il faut donc absolument intégrer cette donnée pour maximiser l’écoute et l’attention.
En plus de l’apparence, la posture physique est également soumise à des biais puisque le non verbal associé classiquement au leadership (affirmation de soi, dominance, extraversion, etc.) n’est pas interprété de la même façon suivant qu’il émane d’un homme ou d’une femme. Les femmes peuvent être jugées plus sévèrement pour des comportements assertifs ou dominants, tandis que les comportements similaires chez les hommes peuvent être valorisés. Les signaux généralement associés à la confiance et à la dominance comme une posture corporelle ouverte, prenant de l’espace, épaules en arrière et buste dégagé, un contact visuel soutenu, des gestes expansifs, un ton de voix bas à forte résonance, des expressions faciales confiantes, ou encore le fait de prendre l’initiative dans les échanges oraux, de diriger les discussions, ou d’empiéter sur la distance proxémique (distance personnelle dans l’interaction entre deux personnes) ne sont pas interprétés de la même façon. Parallèlement, des postures typiquement associées à la féminité (gestuelle discrète, voix douce, regard évitant et modeste, visage penché sur le côté ou vers le bas, taille cambrée, sourire très fréquent, jambes croisées, déhanchement en posture debout, parole en retrait, distance proxémique plus grande) peuvent séduire et/ou rassurer, mais risquent de ne pas convaincre. D’où le dilemme : féminine, mais pas assez leader, ou bien leader mais pas assez féminine …

Heureusement, des pistes existent pour éviter ces doubles injonctions contradictoires. Il a été en effet observé que des femmes leadeuses peuvent être jugées moins négativement lorsque leur performance s’accompagne de traits traditionnellement féminins, comme l’empathie. Certaines études suggèrent que les hommes influents utilisent plus souvent des signaux physiques expansifs de dominance, tandis que les femmes influentes vont se concentrer sur des stratégies verbales et sociales plus subtiles. Par ailleurs, dans certains environnements professionnels, les comportements dominants sont de plus en plus acceptés et encouragés chez les femmes. Et surtout, un travail réfléchi sur son apparence, sa posture et son identité vocale, peut permettre non seulement de neutraliser ces contradictions, mais ensuite d’en faire de véritables atouts.
Quitte à être jaugée et jugée, autant affûter sa stratégie de présentation de soi ! C’est tout l’enjeu du module 2 de notre programme TOTALIMPACT.E POUR FEMMES LEADERS !
